De très courts essais qui ont pour point commun de narrer des faits de contemporanéité au monde. Par sérendipité, on entend des coïncidences fortuites, des faits qui auraient dû avoir lieu mais qui sont passés à la trappe, des prises de conscience toujours inexpliquées, bref, un état d’esprit particulier duquel se dégage une capacité, une aptitude certaine à faire par hasard des découvertes, des trouvailles inattendues, presqu’à notre insu, et à en saisir instantanément leur devenir.
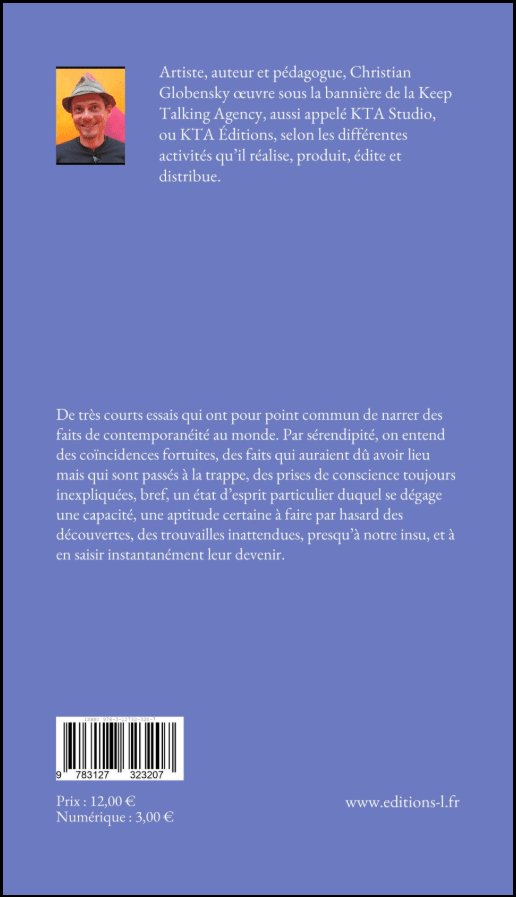
Christian GLOBENSKY
SÉRENDIPITÉ
***
De très courts essais qui ont pour point commun de narrer des faits de contemporanéité au monde. Par sérendipité, on entend des coïncidences fortuites, des faits qui auraient dû avoir lieu mais qui sont passer à la trappe, des prises de conscience toujours inexpliquées, bref, un état d’esprit particulier duquel se dégage une capacité, une aptitude certaine à faire par hasard des découvertes, des trouvailles inattendues, presqu’à notre insu, et à en saisir instantanément leurs devenir.
***
5/ L’Aube de la modernité
- « Car il n’y est de point [sur ce torse] qui ne te voie.
- Tu dois changer ta vie. »
- Rainer Maria Rilke, iŒuvres, 2, Poésie
C’est par le concept de « torse autonome », découvert auprès de Rodin, et dont il fut le secrétaire particulier de 1905 à 1906, à Meudon, que Rilke expérimenta pour la première fois le phénomène des « tensions verticales », et les manières dont elles sont induites par leur source d’autorité esthétique. C’est par ce biais que Rilke s’inscrit dans la percée de l’art moderne vers le concept de l’objet qui se dit lui-même, et une forme de réorganisation de son existence en exercice. Avec son poème, Torse archaïque d’Apollon, de 1908, il acquiert la certitude que c’est des choses elles-mêmes, de ce qui est là, devant lui, que doit émaner toute autorité.
Rilke aurait découvert le modèle réel du torse autonome en faisant l’inventaire de la collection personnelle de Rodin, aujourd’hui au Musée Rodin, à Paris. On ne peut vraiment mesurer l’influence qu’aura le sculpteur démiurge sur lui. « Les hommes ne causaient pas avec lui. Des pierres lui parlaient », dira-t-il de Rodin. Et à propos de ses sculptures : « il y avait infiniment d’endroits, il n’y en avait aucun où rien n’arrivât ». Par ce concept d’objet entendu comme une chose singulière qui prétend à l’intégralité de notre regard, Rilke fait l’expérience nouvelle d’un ordre venu de la pierre où la multiplicité des points que compose la surface de la pierre mutilée se révèle être autant d’yeux qui le regardent. Dès lors, il accomplit « une opération dotée d’une qualité “microreligieuse“ et que l’on reconnaît sur tous les plans, une fois compris, comme le module primaire d’une action intérieure “ pieuse “… » Mais ici, point d’attracteur céleste, ni d’autorité divine, mais une disposition que l’on porte avec soi, comme un don qui appelle à se développer de lui-même. « Le salaire de ma propension à participer à cette inversion de l’objet et du sujet me parvient sous la forme d’une illumination privée — dans le cas présent, sous celle d’un saisissement esthétique. »
« La manière dont Rilke éprouve le torse d’Apollon témoigne du même tournant culturel que pistait Nietzsche (…) le combat paradoxal de la vie en souffrance contre elle-même »
En marge de l’exposition universelle de 1900, à Paris, Auguste Rodin fait construire le Pavillon de l’Alma, entièrement dédié à son œuvre. Le projet est fort ambitieux et requiert l’appui financier de trois banquiers. Rodin souhaite en fait que le pavillon devienne un musée permanent, mais un musée qui soit aussi un atelier de production d’œuvres. Un concept révolutionnaire pour l’époque, mais qui devra être abandonné, pour des raisons financières et de sécurité. Le Pavillon sera finalement démonté et reconstruit à Meudon et deviendra son nouvel atelier musée où des visiteurs du monde entier se presseront — c’est l’incroyable Musée Rodin Meudon dont la visite reste encore aujourd’hui une expérience unique en son genre. Et c’est aussi lors de cette exposition universelle que Rodin récupère cinq moulages du Bouddha du Borobudur en méditation exposés au pavillon des Indes néerlandaises, et qui viendront compléter sa collection personnelle qui comptait déjà plus de 6000 pièces. Il installera l’une d’entre elles en extérieur dans les jardins de Meudon. « Un plâtre javanais, que je trouve maintenant la plus belle sculpture. Ah, la sereine pensée comme le temps, elle est à l’unisson. Nirvana jouissance sans mouvement. »
Parce que le dépassement de soi requiert avant tout un don de soi, la renaissance esthétique survient lorsque vous prodiguez autant de bienfaits que la nature le fait pour vous. Ni plus ni moins beau qu’un coucher de soleil, « un Claude Lorrain pensé à l’infini », dira simplement Nietzsche, en hommage au peintre français par excellence des couchers de soleil.
Pour Rodin, Meudon fut plus qu’un simple lieu de création, mais bien une résidence isolée des tumultes parisiens, hors du temps. Avant même d’être un atelier, Meudon fut un lieu de méditation et d’expérimentations intensives du phénomène des tensions verticales à l’air libre, en l’absence de toute hiérarchie et autorité esthétique que Rodin a repoussés avec une énergie et une puissance plastique toujours aujourd’hui palpable. « Être paysage» disait encore Rilke de Rodin, ne faire plus qu’un avec la puissance artiste de la nature — selon l’expression de Nietzsche — et qui en bout de course, rien ne pouvait mieux exprimer que ce plâtre javanais, ce Bouddha tout en tension verticale dénuée de toute arrogance dans l’exercice de sa jouissance sans mouvement, mais porté par les millénaires. L’Ordre venu de pierre ouvrait une brèche où tous les temps devenaient contemporains à l’observateur, où sereine pensée et temps sont à l’unisson. Rilke fut le témoin involontaire de ce théâtre de création reclus du monde où des centaines de vie et de générations étaient jours après jours réanimées dans l’ordre la pierre, loin de tout ordre philosophico-morale et religieux.
.
***
- « Nous incarnons depuis quelques siècles un certain type d’humanité : des hommes formés
- à la recherche d’intensification plutôt que de transcendance, comme l’étaient les hommes d’autres époques et d’autres cultures. »
- Tristan Garcia, La vie intense une obsession moderne.
4/ Rejouer l’Odyssée, ensemble
Si l’on en croit Apollodore le Mythographe, auteur de la Bibliothèque, premier ouvrage recensant les récits de la mythologie grecque, Ulysse serait le dernier représentant de l’âge des héros. Il donna même son nom à l’un des deux plus fabuleux poèmes épiques du monde occidental, l’Odyssée. Si certains auteurs, comme Machiavel, Sade ou Kafka ont prêté leurs noms à la création de nouveaux mots, « machiavélisme », « sadisme » ou « kafkaïen », le nom d’Odusseús — Ulysse en grec ancien —, est devenu par extension le nom commun pour désigner un voyage aux milles péripéties, au sens propre comme au sens figuré. Et si l’on connaît essentiellement le monde des anciens Grecs par les chants d’Homère, qui tous célébraient à leur façon la force et la grandeur des héros grecs, il va sans dire que le magnanime Ulysse aux mille ruses a marqué les consciences et le langage de son empreinte.
Pour les Grecs d’Homère, seuls la nature et les dieux sont immortels. L’homme, en tant qu’individu doué de sa volonté propre, s’arrache à la nature et devient, de ce fait, mortel. C’est pourquoi le jeune Achille, l’autre grand héros grec, celui de l’Iliade cette fois-ci, qui au lieu d’une vie longue et sans éclat fait le choix d’une vie courte mais glorieuse, dit sans détour que le seul moyen par lequel les hommes peuvent rivaliser avec les dieux est leur capacité à imprimer une permanence au devenir, à leurs actions, à rendre celles-ci mémorables. Plus que tout autre, Ulysse se démarque non pas par sa force physique, mais par son esprit, son intelligence et ses ruses qui lui permettent d’entrevoir ce que pourra être le réel à venir. C’est ainsi qu’il peut infléchir le destin. À l’image de cette ruse du « cheval de Troie » qui sera à tout jamais attachée au nom d’Ulysse, et dont l’expression désigne pour nous encore aujourd’hui un don qui s’avère être un piège pour ceux qui le reçoivent. Par deux fois, sorcière et déesse, Circée et Calypso tenteront de détourner Ulysse de sa destinée, de son épouse, Pénélope, en ne lui offrant rien de moins que l’immortalité, qu’il refusera, par deux fois. D’une manière certaine, le divin Ulysse surpasse les dieux par le refus de leurs présents.
Si le nom d’Ulysse évoque à lui seul toute la souffrance du monde vécue par un seul individu, en voulant s’affranchir de la destinée que les dieux ont tenté de lui imposer, le nom de Pénélope est quant à lui à tout jamais rattaché à l’image de la femme fidèle, fidèle à son mari — mais, et on ne le dit jamais assez, tout aussi rusée et stratège que son époux. Des auteurs anciens tendent à considérer que le nom Pénélope vient de πηνέλοψ / pênélops, qui désignerait une espèce d’oie sauvage. Ce qui ne manquera pas d’attirer notre attention pour plus d’une raison. En premier lieu, et selon les scholies de Pindare, Pénélope aurait été jetée enfant à la mer par son père, Icare roi de Sparte, mais miraculeusement sauvée par des oies sauvages et ramenée sur le rivage. La seconde raison, on la retrouve dans une trouvaille magistrale que recèle un livre peu connu de l’autrice à succès de La Servante écarlate, Margaret Arwood, livre intitulé, L’Odyssée de Pénélope —mais aussi, d’une certaine façon, l’Ulysse de Pénélope, et l’on n’est pas déçu.
Pénélope n’a que seize ans lorsque, gagnée à un concours organisé par son père, Ulysse lui fit quitter son giron familial, pour l’a menée en Ithaque. Rien que pour ça, Pénélope s’éprend très vite de son nouvel époux, et qui plus est, devient admirative, buvant ses paroles, ses récits, ses ruses. Car Ulysse n’est pas genre à se détourner d’elle une fois plaisir consommé. Au contraire, il lui apprend tout ce qu’il peut lui apprendre, la regarde souvent, en silence, d’un air pensif, comme si elle était un animal étrange, pensait alors Pénélope. Mais elle découvrira bien vite, qu’il faisait ça en toute circonstance, scrutant le présent pour mieux voir l’avenir…
« On connaît moins ce massacre, celui des servantes infidèles à Pénélope. Il est pourtant bel et narré par Homère. Et la tristesse éternelle qui fut le lot de Pénélope n’appartient pas au récit homérique. »
Vingt ans plus tard, lorsque l’Ulysse-mendiant réapparait en son palais d’Ithaque, Pénélope le reconnaît instantanément, mais comprend aussi qu’elle ne peut pas mettre en péril sa nouvelle ruse. Celle qui avait tissé et détissé sa toile, afin de gagner du temps auprès des prétendants — ruse qui sera finalement découverte, parce que révélée par quelques-unes de ses servantes acquises aux prétendants — usera bientôt d’une autre ruse, pour aider Ulysse à se dévoiler avec éclat et procéder au massacre des prétendants. « J’ai décidé de ressortir l’arc d’Ulysse, [dit-elle à l’Ulysse-mendiant], celui dont une seule flèche avait traversé les trous de douze fers de hache — prouesse —, de mettre les prétendants au défi de répéter l’exploit et de m’offrir en récompense au vainqueur. […] Qu’en disait-il ? Il a jugé l’idée excellente. »
Ayant repris confiance en elle, parce qu’elle venait de prouver à Ulysse qu’elle n’avait rien perdu de son intelligence, de sa ruse complice, qui avait toujours été la quintessence de leur relation passionnelle, Pénélope s’ouvrit encore un peu plus au faux mendiant déguenillé, en lui relatant l’un de ses rêves récents. Il concernait son troupeau d’oies blanches, auxquelles elle était très attachée. Ses adorables oies blanches picoraient dans la cour du palais quand tout à coup un aigle au bec crochu avait fondu sur elles et les avait toutes tuées. Pénélope ne pouvait cesser de pleurer — elle tue ce dernier détail à Ulysse. Promptement, l’Ulysse-mendiant lui donna son interprétation : « l’aigle était mon mari, les oies, les prétendants, et l’un allait bientôt se charger d’assassiner les autres. Quoi qu’il en soit, Ulysse a mal interprété le rêve. Lui-même était bel et bien l’aigle, mais les prétendants n’avaient rien à voir avec les oies. Ces dernières étaient plutôt les douze servantes, comme je n’allais pas tarder à m’en rendre compte — constat qui m’a valu une tristesse éternelle. »
On connaît moins ce massacre, celui des servantes infidèles à Pénélope. Il est pourtant bel et narré par Homère. Et la tristesse éternelle qui fut le lot de Pénélope n’appartient pas au récit homérique. Pas plus que la fausse interprétation de la part d’Ulysse du rêve de Pénélope. Il revient à Margaret Arwood, qui, comme l’on sait, deviendra célèbre avec son cycle de La Servante écarlate, d’avoir pointé, avec une infinie justesse, ce qui en a réellement été de l’Odyssée de Pénélope. Pour les Grecs d’Homère, seuls la nature et les dieux sont immortels. L’homme, en tant qu’individu doué de sa volonté propre, s’arrache à la nature et devient, de ce fait, mortel. C’est pourquoi le monde animal, le monde végétal est si signifiant, et qui plus est, toujours potentiellement une incarnation du monde des dieux.
Dans son très beau livre, Botaniser l’Odyssée, Laurent Dubreuil ose une question troublante, que l’on pourrait résumer ainsi : de quel temps Ulysse est-il le contemporain ? « Les végétaux de l’Odyssée ne sont pas de vains ornements. Ils signent, ils désignent. Dans la consistance du récit, ils instaurent une impossible historicité qui participe du projet poétique. » L’enquête est passionnante, elle tend à démontrer qu’Ulysse navigue dans des époques qui semblent remonter beaucoup plus loin dans le temps que celle attribuée par les historiens à l’épopée de la guerre de Troie. L’auteur évoque aussi un vase du v° siècle conservé à Berlin montrant le massacre des prétendants.
« D’un côté du vase, Ulysse a bandé son arc, et sa flèche s’apprête à fendre les airs ; de l’autre, un homme est transpercé quand ses compagnons essaient de se protéger. Le diptyque est saisissant. » Ces deux scènes sont reliées, quoique la nature de l’objet les interrompe de part et d’autre des anses figurées par des ornements exubérants en forme de palmiers. L’auteur cite même une chercheuse pour qui « l’impression qui en résulte est que les flèches sont passées à travers la décoration florale. » Et poursuit en guise de conclusion, affirmant que le peintre fait voir combien, dans l’Odyssée, l’histoire d’Ulysse passe à travers le monde végétal. Mais ce que l’auteur ne dit pas, curieusement, c’est que la flèche passe d’abord et avant tout à travers les anses, figurant ainsi génialement la célèbre prouesse Ulysse, juste avant le massacre des prétendants.
***
- « Dieu ne peut avoir fait le monde par intérêt – comme l’affirmait déjà au VIIIe siècle avant notre ère le philosophe indien Kapila – car, il n’a besoin de rien. » Précédant de deux siècles Héraclite, Bouddha et Confucius, Kapila est le réputé fondateur de l’un des six systèmes philosophiques indiens, le Samkya. Et comme Bouddha, ilse serait déclaré « Éveillé » de son propre chef. « Dieu ne peut avoir fait le monde par intérêt, car il n’a besoin de rien ; ni par bonté, car dans le monde il y a de la souffrance. Donc, Dieu n’existe pas. »
3/ Google et Bouddha
Comme le dit Nietzsche avec beaucoup d’à-propos, « lebouddhisme est cent fois plus réaliste que le christianisme » : lorsqu’il survient, l’idée de Dieu est déjà abolie. Bouddha vient au monde vers 550 avant notre ère, dans le bassin du Gange, au Népal, tout près de la frontière indienne. Le prince Siddhârta naît précisément à Lumbini, à proximité de la ville de Kapilavastu dont le nom fut donné en l’honneur de l’antique philosophe, Kapila. Sa famille, les Gautama, de caste guerrière et grands propriétaires terriens, était souveraine d’un petit royaume. Et Nietzsche pointe avec justesse que le bouddhisme émerge dans les classes dominantes de la société indienne, en opposition au christianisme, qui est une « religion sémitique du “non“, création des classes opprimées ».
La légende raconte que le prince SiddhârtaGautama grandit sans même se douter que la pauvreté eût existé. Et c’est bien ce que ses parents avaient souhaité, mais en vain. Sitôt la souffrance du monde découverte, la maladie, la vieillesse, et la mort, Siddhârta en éprouve aussitôt toute l’horreur, tout le dégoût qui peut s’emparer de n’importe quelle destinée humaine et l’anéantir dans une fin tragique et injuste. Il renonce alors au trône et quitte son palais, femme et enfant, résolu à trouver une façon de remédier à cette souffrance universelle qui accable toute vie. Cette réaction paroxysmique à la souffrance d’autrui peut vous sembler aujourd’hui bien étrange, et ranger le Bouddha du côté des saints et des illuminés à tous vents. Mais ce serait là une grave erreur.
« Première certitude, premier but : il vous faut donc commencer par revisiter la puissance du phénomène esthétique afin de progressivement créer une ambiance qui sera favorable à l’éclosion du surhumain, à l’éclosion d’un humain, post humain. »
Le bouddhisme, vous allez vous en convaincre, est une philosophie postmoderne, parfaitement bien adaptée à notre monde contemporain. Nietzsche comme Bouddha nous ont montré tous les « échelons » qui mènent à l’Éveil, au Surhumain, à une renaissance esthétique. Et contrairement au chrétien qui, comme l’a souligné Nietzsche, est un homme qui se comporte comme n’importe quel autre, l’homme recherchant l’idéal de la renaissance esthétique s’efforce de créer une parfaite symbiose entre le futur et son présent. Voilà un point sur lequel nous ne pouvons avoir aucun doute et qui est, en quelque sorte, le prologue commun à Nietzsche et à Bouddha, un éternel retour du futur au présent, hymne véritable à la création : « Je vous enseigne le surhumain. L’homme est quelque chose qui doit être surmonté. »
Peut-être n’êtes-vous pas sans savoir que le surhumain est à la mode aujourd’hui. Et comme beaucoup de modes émergentes, celle-ci nous vient de la Sillicon ValleyenCalifornie, sponsorisée à grands coups de millions de dollars par Google. Elle a un nom, le « transhumanisme », et ses tenants nous promettent l’avènement d’un homme « augmenté », un être humain qui serait délivré de ses entraves biologiques, non plus grâce à la méditation, à la philosophie, mais grâce aux nouvelles technologies et à la science. Si le transhumanisme se donne comme principal objectif d’abolir les contraintes de la condition humaine et revendique le droit à courir ce risque, ce qui frappera votre esprit dans un premier temps, c’est précisément l’énumération de celles-ci : la souffrance, la maladie, la vieillesse, et la mort. Et vous vous direz que ce sont précisément là les quatre prises de conscience qui ont poussé le Bouddha à quitter son palais et sa richesse pour les chemins de l’éveil au surhumain.
La véritable force de cet idéal ne peut véritablement se comprendre hors de son ambiance, celle dans laquelle vivait le Bouddha, une ambiance selon Nietzsche « devenue hyper-cérébrale, qui ressent trop aisément la souffrance », et celle de notre postmodernité, contre laquelle Nietzschenous a déjà mis en garde : l’art doit nous préserver des mensonges de la science. Première certitude, premier but : il vous faut donc commencer par revisiter la puissance du phénomène esthétique afin de progressivement créer une ambiance qui sera favorable à l’éclosion du surhumain, à l’éclosion d’un humain, post humain.
***
2/ Les chevaux de Fritz
- « Ce qui importe à Nietzsche, c’est une allochronie radicale, une altérité temporelle de principe au cœur du temps présent. »
- Peter Sloterdijk, Tu dois changer ta vie,
- le projet antiquité de Nietzsche.
On connaît la fin. Assoupi sur sa table de travail, Nietzsche relève la tête, chevelure ébouriffée, hagard, mais semblant tout de même scruter un au-delà du temps, terrifiant mais familier, distant mais à portée de main. Aussi curieux que cela puisse paraître, c’est au beau milieu des fracas de la bataille de Woerth, que Nietzsche médita son ouvrage le plus énigmatique, voire ésotérique, qu’est la Naissance de la tragédie, sous les murs de Metz, dans les froides nuits de septembre, tout en assurant son service d’infirmier. Auprès des soldats malades, souffrants et agonisants, un abîme de terreur et d’horreur s’empare alors de ses pensées. Malgré la brièveté de cette expérience, les impressions laissées par cet « endroit effroyablement ravagé, semé d’innombrables et lamentables débris tout imprégnés d’une odeur de cadavre », furent très profondes. Cris, horreurs, colonnes de flammes éveillèrent chez le jeune Nietzsche tout un ensemble de « visions », comme il le dira plus tard dans son autobiographie, Ecce homo, etdont la recension de son premier livre va s’employer à rétablir la cohérence. « Visions » qui seront aussi ses premières expériences en matière d’illuminations. Dans sa chambre de l’auberge turinoise, Nietzsche reprend la plume, et inscrit sur une page vierge positionnée bien au centre de sa table de travail : « Ecce homo — Chapitre 1 — Naissance de la tragédie ».
Sur des chemins solitaires, subsistant de presque rien, s’arrêtant ici et là dans de petites auberges en réclamant « une chambre tranquille pour philosophe », Nietzsche réanime en lui un flot de « visions », une constellation d’illuminations spontanées qu’il avait déjà consignées dans son premier ouvrage, Naissance de la tragédie (1872), lorsqu’il était jeune professeur à Bâle. Si toutes les universités allemandes disaient du Nietzsche de cette époque qu’il était « scientifiquement fini », le jeune philosophe pense pour sa part, le sourire aux lèvres, qu’on ne réfléchit bien qu’en marchant. Mais il ne s’agit pas simplement d’avoir des idées, encore faut-il qu’elles aient une « valeur ». Conséquence du courage, cette valeur se mesurera à la nature tout entière qui se dépose en vous, et par la grâce de laquelle, les énoncés intellectuels trouvent leurs véritables dons.
Cette chambre tranquille pour philosophe, où il a terminé son autobiographie quelques semaines plus tôt, son tout dernier manuscrit, est situé au 6 Via Calberto, à Turin. On connaît la suite. Elle très bien restituée par Guy Bolet, dans l’ouverture de son livre À ma sœur unique. C’est une anecdote célèbre, connue de tous les lecteurs de Nietzsche. Le 3 janvier 1889, à Turin, Friedrich Nietzsche sort d’un pas mal assuré de l’auberge turinoise et croise une voiture dont le cocher fouette violemment son cheval, il s’approche alors de l’animal, l’enlace par le cou, éclate en sanglots, semble lui dire des choses à l’oreille, interdisant un temps à quiconque d’approcher, et s’effondre finalement par terre. C’est le début de la fin. Le propriétaire de l’auberge ramène tant bien que mal « le Professeur » dans sa chambre. Un policier turinois fait les premiers constats, et fait le décompte de ses effets personnels : « Huit paires de chaussettes, quatre chemises de nuit, trois chemises de laine, deux pantalons, une bonne veste et manteau épais. » C’est tout ce que Friedrich Nietzsche possède au terme de sa quarante-quatrième année.
« J’ai rencontré moi aussi sur ma route plus d’un esprit singulier et dangereux, rien moins que le dieu Dionysos, le grand dieu ambigu et tentateur, moi le dernier, me semble-t-il, à lui avoir offert un sacrifice… »
Une anecdote bien moins connue, même des lecteurs de Nietzsche, est aussi délicieusement narrée par Guy Bolet, toujours dans son À ma sœur unique. Elisabeth, la sœur de Nietzsche justement, n’aura de cesse de la répéter à son frère durant les années où ils vécurent ensemble. La scène prend place dans un cirque, c’est leur mère qui, pour le quinzième anniversaire de Fritz, avait offert des places de spectacle. Lorsque rentre en piste de dresseur d’animaux, celui-ci présente un cheval nommé Cosinus, qu’il dit savant. Et le cheval s’exécute, quelques additions simples en tapant du sabot, répond par un ou deux hennissements à des questions amusantes. Mais le clou du spectacle se fait annoncer par un éclairage dramatique et la voix maintenant mystérieuse du dresseur : « Je sais, Mesdames et Messieurs, qu’il y a dans cette ville, ou à proximité, un institut savant dont la réputation a aisément franchi les frontières du canton… ». Il fait allusion ici au collège de Pforta, dont la salle est emplie d’étudiants. Et il affirme que son cheval va parvenir à designer qui, de cette grande école, sera promis à un bel avenir et une grande destinée. « Cosinus fait trois fois, ses sabots dans le sable, le tour de la piste, puis, brusquement, comme si le Ciel lui-même lui avait désigné lequel de ces élèves sera l’heureux Élu : s’arrête pile face à Fritz. »
Bien que le livre À ma sœur unique soit admirable à tout point vue, on attendra en vain jusqu’à fin qu’un rapprochement soit établi entre ce début mystérieux où le jeune Fritz sent ou pressent dans le regard de ce cheval de cirque s’illustrer son destin, et la fin tragique du cheval de Turin. Point un mot n’est dit. Et pourtant : qu’a-t-il bien pu murmurer à l’oreille de ce cheval battu ? Qui voit-il dans cet animal ? Cosinus ? Ou bien, ou bien encore… Le 3 janvier 1889, Nietzsche est encore et toujours un parfait inconnu, personne ne s’est intéressé à son œuvre littéraire et philosophique — hormis un éditeur scandinave qui vient tout juste de lui envoyer un courrier, dont on ne sait s’il est réellement parvenu jusqu’à lui.
« Un livre impossible », Nietzsche le savait, de par son caractère initiatique, quelque chose d’indicible, et déjà, un « évangile de l’harmonie universelle ». Et pour cause, le livre réhabilite « la puissance artiste tout entière de la nature », que Nietzsche nommera simplement Dionysos, mais aussi, entre les lignes, Bouddha. « J’ai rencontré moi aussi », nous dira-t-il à la toute fin de Par-delà bien et mal (1886), livre qui suit immédiatement son chef-d’œuvre planétaire, Ainsi parlait Zarathoustra (1883) : « j’ai rencontré moi aussi sur ma route plus d’un esprit singulier et dangereux, mais surtout celui dont je viens de parler et je n’ai cessé de parler de lui, rien moins que le dieu Dionysos, le grand dieu ambigu et tentateur, auquel, vous le savez, je consacrai autrefois mes prémices, en grand secret et vénération », — vous avez bien compris, Nietzsche désigne ici sans ambiguïté Naissance de la tragédie —, « moi le dernier, me semble-t-il, à lui avoir offert un sacrifice… »
***
- « J’ai volé trop loin dans l’avenir un frisson d’horreur m’a assailli et lorsque j’ai regardé autour de moi voici que le temps était mon seul contemporain »
- AU PAYS DE LA CIVILISATION
- Ainsi parlait ZarathoustraNietzsche
1/ Vernissage, musée des Beaux-Arts de Nancy
Dans cette maison a été déposé et veillé le corps de CHARLES LE TÉMÉRAIRE, tué à la bataille de Nancy le 5 janvier 1477
À quelques centaines de mètres du Musée des Beaux-arts de Nancy, sur la Grand-Rue, chemin emprunté pour rejoindre mon hôtel, on peut apercevoir cette plaque commémorative citée en exergue. On doute que cette maison soit authentique et qu’elle n’ait pas fait l’objet de multiples reconstructions, mais pour qui connaît les collections du musée des Beaux-arts, c’est d’abord à Eugène Delacroix que l’on pense, et son immense tableau (2,27 m sur 3,56 m), intitulé La Bataillede Nancy, de 1833. Entourés d’une armée de soldats à pied et de cavaliers disposés en rang se perdant dans le lointain, les deux principaux protagonistes de la scène se dégagent au premier plan. Il s’agit du chevalier de Beauzémont, au centre, paré d’une armure, à cheval, qui s’apprête à porter un coup de lance fatal à Charles le Téméraire situé en bas à gauche du tableau, en mauvaise posture, désarçonné. Il ne survivra pas. Sa dépouille sera portée au centre de Nancy, et veillée.
« J’étais tout à coup contemporain de tous les temps, je devenais l’espace d’un instant un camarade du temps et la chambre des téléportations se trouvait au Musée des Beaux-Arts de Nancy. »
AArrivé rue de Guise, où est situé mon hôtel, une ambulance et une voiture de police sont stationnées, gyrophares actionnés, transfigurant les immeubles en une scène d’un rouge haletant. Je pense ensuite à Jean Baudrillard, et ses Cool memories, où il décrit cette sensation étrange que l’on ressent au sortir d’un musée italien ou hollandais pour entrer dans une ville qui semble le reflet même de ses peintures, comme si elle en était issue et non l’inverse. Une rêverie s’en suit sur les manières dont nous emplissent nos perceptions. Il me semble tout à coup que la créativité repose sur une sorte d’interaction étrange, un va-et-vient entre des niveaux d’interprétation, étrange parce qu’inattendue, un double point de vue dans un contexte donné, par lequel une proposition pourra se dédoubler dans une lecture à la fois rationnelle et poétique, scientifique et intuitive. Enfin, que l’acte de création naît dès lors qu’il a le pouvoir de se refléter dans ces différents niveaux d’interprétation, que sont l’éthique et l’esthétique. Qu’éternellement, c’est l’esthétique qui justifie l’éthique, la valeur et le sens que l’on donne à notre vie, et non pas l’inverse.
Levé tôt, et ayant oublié d’emporter quelque chose dans ma valise, je sors de l’hôtel faire une course en un aller-retour. Reprenant la rue de Guise, c’est un corbillard qui est maintenant stationné. La porte de l’immeuble est ouverte et je vois deux personnes descendre sur une civière un corps enveloppé dans une housse mortuaire. Une personne s’est éteinte dans la nuit et on l’a veillée jusqu’au matin. J’étais tout à coup contemporain de tous les temps, je devenais l’espace d’un instant un camarade du temps (« zeitgenössisch »), où se côtoyaient Charles le Téméraire (1477), Eugène Delacroix (1833), l’inconnu décédé de la rue de Guise (2022). Et la chambre des téléportations se trouvait au musée des Beaux-Arts de Nancy.
***
SOMMAIRE
- 1/ Vernissage, musée des Beaux-Arts de Nancy
- 2/ Les chevaux de Fritz
- 3/ Google et Bouddha
- 4/ Rejouer l’Odyssée, ensemble
- 5/ L’Aube de la modernité
Christian GLOBENSKY
Artiste, auteur et pédagogue, Christian Globensky œuvre sous la bannière de la Keep Talking Agency, aussi appelé KTA Studio, ou KTA Éditions, selon les différentes activités qu’il réalise, produit, édite et distribue. Un atelier d’artiste donc, un laboratoire d’art et d’idées. KTA Éditions s’est confrontés en 2014 au livre de développement personnel, avec notamment Comment on devient Bouddha selon Nietzsche. KTA Studio, véritable signature d’artiste, se consacre à l’édition de multiples, de goodies et à leur diffusion nationale et internationale. Artiste plasticien, il travaille l’installation à partir des pratiques de l’écrit, de la photographie, de l’objet et de la performance. Docteur en Arts et Sciences de l’Art (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et diplômé des Beaux-Arts de Paris, Christian Globensky enseigne la pratique et la théorie de l’installation à l’ÉSAL Metz.
